Laurent Jeanpierre –Avec plusieurs personnes, tu as constitué depuis début 2020 un espace de rencontres (qui s’adosse aussi à un site internet), de mise en commun, de partage d’expériences, un espace qui n’a rien de figé, il est en reconfiguration constante quant à ses méthodes, ses objectifs, où plusieurs luttes, plusieurs expérimentations collectives, ancrées d’abord en Ile-de-France, interstitielles souvent, institutionnelles ou contre-institutionnelles parfois, circulent et se parlent. Nous allons aborder ce qui a donné lieu à cette tentative et ce qu’elle fait, au sens le plus concret du terme. Mais avant cela, je voudrais m’arrêter un instant sur le nom que tu lui as donnée : Les Communaux. Il y a derrière ce mot un écart sensible avec d’autres concepts et propositions, théoriques et pratiques, venues réactiver depuis trente ans, certes marginalement, l’espérance communiste. Les communaux ne sont pas la communauté, les communs, ni même le commun, pas plus que la commune. Pourquoi être allé chercher ce terme aujourd’hui en grande partie désuet ?
Josep Rafanell i Orra – Commune, communalisme, le commun, « faire commune », Gilets jaunes communalistes, jusqu’à des extravagances comme Paris en commun… ! Ces termes prolifèrent depuis un certain temps et disent bien quelque chose de notre époque et peut-être de la faillite des anciens paradigmes de la politique de l’émancipation. Je n’ai pas la prétention d’en faire l’analyse. Ni d’être en mesure d’en démêler les généalogies et les formes d’actualisation. Je me contenterai de souligner que les communaux, historiquement, étaient des portions du territoire (pâturages, haies, bordures des chemins, mares, landes, rivières…) qui ne faisaient pas l’objet d’une codification par le droit en termes de propriété, même s’ils pouvaient appartenir à des domaines seigneuriaux. Ou alors il faudrait parler d’un droit coutumier. Nous voyons par ailleurs émerger, depuis quelques années, un puissant courant d’études s’en inspirant pour réinventer le droit sous le signe de la coutume et des usages comme régulateur des formes de vie et de coproduction immanente de normes et de valeurs propres à la communauté. Les communaux étaient donc de « lieux » définis par une imbrication d’usages disparates. On peut dire alors que le « commun » des communaux résulte d’une coexistence de pratiques. On connaît la suite avec le mouvement des enclosures… Il s’agit donc, d’une certaine manière, de réactiver cette histoire.
Mais il y a encore quelque chose qu’il me semble important de souligner dans notre époque de démesure qui a rendu la Terre si minuscule. Des descriptions des anciens communaux se dégage un autre aspect : ces usages étaient régis par le sens de la sobriété, au plus loin des logiques d’accumulation (ce qui rendit possible l’une des justifications « morales » du processus des enclosures : l’improductivité des communaux !). Il y a dans les communaux un sens de la « proportionnalité » au sens où l’entend Ivan Illich dans ses théorisations de la convivialité.
Si avec les communaux il y a donc une absence de la propriété, en tant que possession exclusive et excluante, cautionnée par des actes ou titres juridiques, il n’y a pas pour autant absence d’appropriation. Redisons-le alors avec les mots de David Lapoujade dans Les existences moindres : « approprier » c’est donner des propriétés à des relations et par là, « intensifier des existences ». De telle ou telle manière. On peut par-là renouveler la question de l’autonomie : les modes d’existence, qui ne peuvent être que des formes de coexistence, nous indiquent que l’autonomie, ce n’est paradoxalement rien d’autre que les formes d’interdépendance situées entre des êtres qui luttent avec acharnement contre l’hétéronome abstraite imposée par les institutions du gouvernement.
Il faudrait, autrement dit, partir du postulat suivant : le monde commun ne préexiste pas à l’expérience que l’on en fait. Cela signifie aussi que le commun résulte des pratiques de communisation. Il ne saurait d’ailleurs se confondre avec l’abstraction d’un bien public qui est toujours l’effet de dispositifs de gouvernement et de ses distributions sociales. Il ne saurait encore moins s’identifier à un intérêt général dont on voit mal comment il ne coïnciderait pas avec l’entreprise de séparation dont l’économie et son gouvernement sont l’expression. Pas d’institution d’un commun déjà donné ni de législation supérieure. Mais seulement des formes de partage et des alliances, des manières de s’organiser, des obligations réciproques construites pas à pas, de proche en proche, dans des situations singulières.
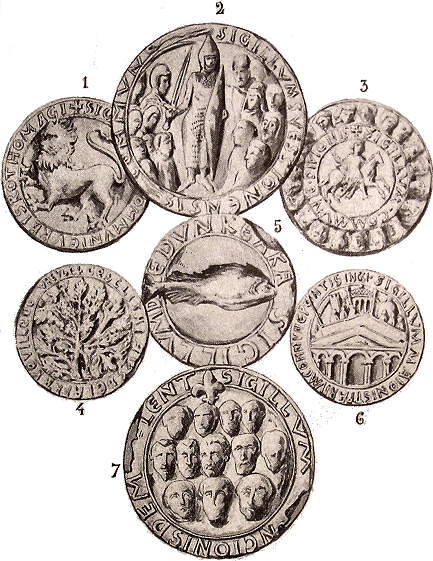
Laurent Jeanpierre – Peut-être serait-il nécessaire de dire ici quelques mots sur l’origine de l’expérience des « Communaux » ?
Josep Rafanell i Orra – Pendant trois ans, Les Laboratoires d’Aubervilliers (une institution !) avaient accueilli un cycle de rencontres appelé « Pratiques de soin et collectifs » puis « Quelles autonomies ? ». Il s’agissait de susciter un croisement d’expérimentations autour du soin, dans, en dehors, aux frontières des institutions, ou en conflit avec celles-ci. Ces rencontres convoquaient les mondes de la psychiatrie, de la maladie somatique, des usages de drogues, des travailleurs et travailleuses du sexe, de nos rapports aux plantes et aux terres urbaines… C’est ainsi que nous avons accueilli des groupes d’entraide mutuels (GEM), des membres du réseau d’entendeurs de voix (REV), des animateurs d’alternatives à la psychiatrie telles L’Autre lieu de Bruxelles, des groupes d’auto-support d’usager·e·s de drogues comme ASUD, des collectifs de travailleuses du sexe comme Roses d’Acier, l’institut de recherche Dingdingdong autour de l’expérience de la maladie d’Huntington, des électrosensibles, des collectifs médics intervenant dans des contextes de violences policières, des artistes intervenant auprès des enfants en milieu scolaire, des expériences d’hospitalité à l’égard des migrants. Nous avons suscité aussi le partage de recherches dans des cadres plus académiques autour de la généalogie du dualisme occidental, du retour aux expériences historiques d’autonomie politique, des tentatives de redéfinition du communisme, des approches pragmatistes dans les champ de la philosophie, de la résurgence des pratiques spiritualistes à partir de recherches anthropologiques sur les néo-chamanismes, des études historiques sur les ravages environnementaux et les nouvelles formes de gouvernementalité qu’ils ont suscité… Ce processus s’était conclu, avec le soutien des Laboratoires d’Aubervilliers, par un livre collectif, Itinérances, publié par les Éditions Divergences en 2018.
L’expérience des Communaux est née début 2020 comme une prolongation de ce processus. Elle s’inscrivait d’emblée dans la perspective d’intensifier ces liens, de poursuivre le partage d’enquêtes multiples, de potentialiser des initiatives hétérodoxes au regard des institutions. Avec les Communaux il s’agit donc de faire consister, par coalescence, cette trame d’amitiés, de complicités, d’alliances entre des expérimentations collectives concrètes et des recherches. Certaines sont ancrées dans des territoires, d’autres prennent davantage la forme de dispositifs « nomades », les unes et les autres suscitant des nouveaux agencements.
Nous voulons être attentifs aux processus d’émergence de nos expériences par hétérogenèse, c’est-à-dire à partir de la rencontre entre des manières singulières de les faire exister. Ceci suppose aussi de tenir compte des environnements institutionnels. Des conflits qui s’ouvrent avec les institutions. Ou parfois des manières de les altérer en créant des alliances. Il est vain d’imaginer que nous allons nous passer, du jour au lendemain, de la psychiatrie, des univers assistanciels, de tout un pan des « services publics » qui vivotent… Dès lors, il faut, autant que faire se peut, contraindre l’institution à devenir poreuse à des expérimentations dissidentes. Ceci suppose que puissent avoir lieu des processus de « désidentification » — des acteurs du soin et de l’assistance institutionnelles, si l’on prend les exemples cité — en même temps que des formes de désassignation de l’expérience des « usagers » aux places qui leur sont accordées.
À ce propos je partirais d’un présupposé : nous avons besoin de profondes ruptures « politiques », mais nous ne pourrons nous passer d’aucune manière de transitions techniques. Il nous faut situer des techniques pour sortir, et du quadrillage infrastructurel des réseaux technologiques, et de l’emboîtement des institutions étatiques qui composent les distributions sociales à partir de techniques de soi basées sur la subordination. Appelons cette transition la création de « communs » techniques. Il nous faut faire émerger ce que Yuk Hui appelle des cosmotechniques au regard du monde technologique (des techniques situées, ayant le sens de la proportionnalité au regard de la communauté) et des communs des services publics (communs de la santé, de la psychiatrie, dispositifs de mutualisation face à la fragilité des existences). Ceci concerne donc aussi bien le psy que le médecin, le mécanicien de voitures que le développeur informatique, l’ingénieur agronome que le paysan. Faire consister des pratiques de coopération est une question éminemment technique. Ce sont des techniques, toujours situées, qui rendent possible la transmission et la réactivation des héritages permettant ainsi les continuités des expériences collectives.
À la différence des projets communalistes programmatiques, et de leurs versions municipalistes, nous ne partons pas des présupposés déjà donnés instituant un programme « politique » applicable à des quadrillages administratifs du territoire, eux-mêmes déjà organisés. Si quelque chose de l’ordre du politique surgit dans cette aventure, c’est en tant que politique de l’expérience. Ajoutons alors que la part agonistique de l’expérience, à laquelle bien entendu nous ne voulons pas nous dérober, est précédée par des manières de rendre présents ses modes d’existence. La « communauté » des Communaux, n’est donc pas celle d’un collectif rassemblé par quelques idées politiques, mais avant tout une constellation d’interventions qui naissent d’une pluralité de lieux et qui en tissent la trame d’interdépendances. Je propose avec les Communaux de fuir les scènes où l’on devient un juge de la bonne radicalité ; mais aussi de ne se pas donner comme une évidence la dissociation au regard de ce que l’État appelle la violence (manifestations qui débordent, occupations, blocages, sabotages…) pour mieux masquer le monopole qu’il s’octroie de la sienne. Entre un pôle et l’autre, chacun se débrouille avec ses convictions.
C’est à partir de cette logique de mise en constellations que des « champs » d’enquête ont pris forme. Les hospitalités à l’égard des migrants, le soin, les univers de la psychiatrie et des précarités, l’intérêt porté à la culture des terres urbaines et les pratiques populaires de subsistance architecturent les Communaux. Nous portons une attention particulière à la fragilité, à la vulnérabilité, qu’il s’agisse des humains ou des non-humains dans leurs manières relationnelles d’habiter des lieux. Cela va de soi : s’intéresser à n’importe lequel de ces « champs » ainsi artificiellement bornés c’est aussi forcément transversaliser une multiplicité d’expériences. Nous appelons cela des « chantiers » dans lesquels cohabitent praticiens du soin psy ou somatique, travailleurs sociaux, botanistes, jardiniers, bricoleurs, « usagers » des institutions, migrants, urbanistes, architectes, géographes, anthropologues, historiens, chercheurs en sciences « dures », sociologues, philosophes, artistes, membres de collectifs en lutte… Il faut bien sûr dire que celles et ceux embarquées dans ces expérimentations, interventions, luttes, n’ont pas attendu les Communaux… Ceux-ci jouent un rôle d’enchevêtrement et de désenclavement de ce qui s’invente. Forcément, ces dynamiques de partage suscitent des nouvelles créations et d’autres champs d’intervention… Ainsi, on est en train de mettre en projet la création d’une « mutuelle sauvage » pour faire face à des situations d’extrême précarité et soutenir des expériences d’autonomie collective.
Des rencontres ont donc lieu régulièrement autour de tel ou tel chantier. D’autres moments publics sont aussi proposés pour rendre compte de nos travaux d’enquête et de liaison. Un cycle de présentations de recherches plus académiques a été organisé (mis à mal par la situation épidémique). Nous disposons d’un site internet pour mettre en partage des matériaux : des écrits, entretiens, documents audio ou vidéo. Ajoutons qu’un ensemble de lieux disparates, situés surtout dans le nord-est parisien et la banlieue parisienne, particulièrement la Seine-Saint-Denis, nous offrent leur hospitalité. Lieux qui portent avec eux leur propre constellation de liens…
Laurent Jeanpierre – Tout un savoir collectif s’élabore, d’expériences en expériences, de chantiers en chantiers, de réunions en réunions, sur les obstacles, les risques, les chausse-trappes rencontrés par les différentes actions collectives qui participent aux Communaux, dans le soin, l’hospitalité, les luttes écologiques ancrées dans les métropoles, etc. Dans la plupart des expériences, militantes ou non, ce savoir reste oral, il est porté par des personnes singulières, sa transmission est fragile et parfois réservée à quelques-uns, ou bien difficile à écrire. À travers ces échanges, son site, ses activités, le regroupement des Communaux semble en mesure d’inscrire ces savoirs d’usage et de les faire circuler. Est-ce aussi cela que tu appelles « enquête » ou « cartographie » et, parfois même, « cartographie à l’échelle 1 » ? Qu’est-ce qu’une enquête pour toi ? Et une cartographie ? Plus largement : comment conçois-tu la transmission ou la cumulativité des expériences collectives, politiques ou pas ? Pourquoi l’enquête et la cartographie te semblent-ils les points de départ indispensables d’une politique nouvelle que tu viens aussi d’appeler « politique de l’expérience » ?
Josep Rafanell i Orra – Si, avec les Communaux, se dessine une cartographie vivante c’est dans le sens où il s’agit non seulement de lieux géographiquement repérables, mais aussi de liens d’interdépendances et de réciprocités. La singularisation de cette cartographie devient alors indissociable de l’entraide, de la coopération et des alliances qui se tissent.
Je voudrais me permettre un aparté, puisque tu y as fait mention. La question des hospitalités nous importe au plus haut point. C’est par là que les pièges de l’autoréférentialité collective, du dogmatisme idéologique des collectifs politiques, ou que les aspects les plus bornés de la spécialisation peuvent être en partie déjoués. Si l’hospitalité suppose d’accueillir les mondes transportés par celles et ceux qui viennent d’ailleurs, dans le même mouvement, elle « oblige » aussi à questionner le monde où s’engagent ces gestes d’accueil. Alors la question qui se pose à nous est celle-ci : avons-nous un monde pour accueillir d’autres mondes ? Et quel est ce monde ? Et si on n’a pas de monde, il faudra le fabriquer : appelons cela les enchevêtrements multiples de l’amitié. Et on pourra ajouter encore : qu’est-ce qui rend impossible un monde en mesure d’accueillir d’autres mondes ? C’est aussi par-là que naissent des combats.

Mais si la question de l’hospitalité nous importe c’est aussi parce qu’elle lie intimement une culture des différences au refus des identités comme raison du collectif.C’est pour cela que je préfère parler de constellations au sens où celles-ci comportent des régions, des zones formatives de l’expérience qui rendent possibles la rencontre entre des hétérogénéités. Cela n’a rien à voir avec un volontarisme belle âme, ni avec un œcuménisme qui aplatit tout ou avec une tolérance insipide et de façade. Il s’agit de s’embarquer dans des traversées. Et cette passion pour l’ailleurs, pour l’itinérance, nous devons la cultiver. Cela, j’en fais le pari, nous rend plus aimables et nous aide à conjurer la toxicité des identités dans les milieux politiques. Quelque chose de l’ordre de la figure de partisan peut s’affirmer inséparable de l’amitié. Prendre le parti de l’hospitalité c’est affronter le monde qui en dénie la possibilité car nous n’avons de réel monde commun que fabriqué. Les mots de Philip K. Dick, rappelés par David Lapoujade dans L’altération des mondes, pourraient nous convenir ici : la réalité, « il faut la créer, plus vite qu’elle ne vous crée ».
Dans la continuité de ce propos, et pour mieux caractériser les Communaux, il faudrait en effet s’attarder sur une certaine conception de l’enquête que nous essayons de faire vivre. Dans ce cadre, enquêter c’est être attentif aux manières de singulariser une expérience dans un « ici » alors même que nous venons d’ailleurs. L’enquête prend sa consistance dans l’actualité des liens avec d’autres expériences. Lorsque nous nous posons la question de ce qui se passe dans un « ailleurs », c’est parce que celui-ci est indissociable de notre « ici ». En ce sens l’enquêteur accepte de se laisser porter par une connaissance ambulatoire, toujours « en train de se faire », dans un monde en patchwork dont il faut instaurer les passages. Déambuler implique aussi un travail de traduction, un souci pour les versions, un exercice de tact pour dire que ce qui existe ailleurs va peut en être métamorphoser les lieux communs de notre « ici ». N’y a-t-il pas, de la sorte, dans toute enquête, une action de transfiguration ? Les Communaux est un lieu parmi d’autres pour « faire retour » avec l’espoir que nous ne serons pas les mêmes que ce que nous étions avant notre « départ ».
Mais l’enquête est aussi une réactualisation des héritages, ceux qui ont été tronqués, ceux des histoires vaincues ou écrasées. Il y a donc un travail généalogique à l’œuvre, qu’on le veuille ou non, dans chaque enquête de « terrain », un travail qui oriente d’une façon partisane les possibilités déjà contenues dans des anciennes versions. Il est donc affaire de réactualisation. De transmission ensuite.
Enfin, ce travail d’enquête porte en lui la possibilité d’intensifier des alliances. C’est en ce sens que nous pouvons parler d’instauration de cartographies communales. Les cartographies n’ont pas de sens sans ce travail d’engagement porté par des enquêtes partisanes mises en partage, mises en contraste. Nous sommes des partisans de la multiplicité (et ce malgré l’apparent paradoxe contenu dans cette dernière formule).
Laurent Jeanpierre – Je reviens à la question que j’esquissais plus tôt : quelle nuance entends-tu introduire en revendiquant l’emploi du mot Communaux au détriment des autres formules d’inspiration communiste ou communaliste des dernières années ?
Josep Rafanell i Orra – Le problème avec le signifiant « communisme » aujourd’hui c’est qu’il est, soit trop molaire, noétique pour ainsi dire, lorsqu’il se propose comme un programme (dont on ne voit pas comme pourrait-il alors échapper à une vectorisation téléologique) ; soit, dans son effectuation, trop moléculaire, micro-politique et alors raillé comme inoffensif face à la brutalité du bloc de forces et d’opérations d’homogénéisation par déségrégation du capitalisme et de son bras policier, l’État.
Je voudrais juste insister, à l’encontre de la grandiose tradition idéaliste du communisme, que celui-ci est avant tout une culture des sensibilités. Si l’on tient à parler de communisme, c’est de sympathie sensitive dont il est question. Et qui devrait avoir une prééminence sur tout supplément symbolique qui lui viendrait de l’idée. L’idéalisme communiste est un oxymore, il est une contradiction dans les termes qui cache l’impuissance, ou la paresse, devant l’engagement dans des créations de formes de transindividualité. Mais nous savons à quel point, généalogiquement, la matrice culturelle de l’Occident aura établi une surévaluation de l’idée, du concept, des jeux d’abstractions. Dans l’ordre des hiérarchies, on préfère toujours quelqu’un d’« intelligent » plutôt que sensible, ou ayant des perceptions aiguisées. C’est calamiteux. Contre tout cela on pourrait dire : le communisme s’exprime dans des formes de co-individuation, même si l’on comprend aisément qu’il puisse par ailleurs être brandi comme un mot d’ordre mobilisateur contre l’action tentaculaire de destruction du capitalisme.
Ce communisme des pratiques, le seul qui m’intéresse, demandera, bien sûr, de nouvelles formations sociales dont les devenirs possibles ne me semblent pouvoir être que communalistes : des formes d’organisation qui conjurent les médiations de la représentation qui nous absentent du monde. Dans ce sens, je ne sais plus ce qu’il restera alors du « social » comme totalisation. Rappelons ici le vers que composa Agustín García Calvo en parodiant l’hymne d’Espagne : « tout n’est jamais tout, il y a toujours quelque chose de plus ». Et ce plus, j’aimerai l’appeler « communisme ». Ceci est équivalent à la formule qui, dans Mille plateaux, définit les multiplicités : N-1.

