Le dénouement
En août 1945, Alexandre Kojève, agent du KGB, haut fonctionnaire hors cadre au ministère des Finances, gaullo-stalinien proclamé, négociateur des accords du GATT à la Havane côté français, inspirateur de la position française dans le cadre du plan Marshall, future cheville ouvrière, s’il en fut, de la construction de la Communauté Économique Européenne, élabore l’« esquisse d’une doctrine de la politique française » pour l’après-guerre. Cette esquisse est restée fameuse pour sa proposition d’un « Empire latin ». Kojève y reprend en fait le projet d’une « Union latine » formulée en cet été 1945 par le résistant occitaniste Jean Cassou. Cette proposition est si peu le fruit des circonstances que Kojève ne cessera de la réélaborer, et ce jusqu’en 1949. L’analyse qu’il fait alors de la position de la France, et que les décennies écoulées n’ont pas démentie, repose sur le constat schmittien que « les États-nations, tout puissants encore au XIXe siècle, cessent d’être des réalités politiques […]L’État moderne n’est vraiment un État que s’il est un Empire. » De là, il déduit la situation de la France comme prise entre deux « Empires » ; l’Empire anglo-américain englobant l’Allemagne, fondé sur le culte protestant du travail, de l’économie et déployant un productivisme de type individualiste d’une part, et de l’autre l’Empire slavo-soviétique d’inspiration orthodoxe dont le productivisme est, lui, de nature collectiviste. Il ne voit d’autre survie pour la France, notamment face à l’inexorable hégémonie économique de l’Allemagne, que l’édification d’un « Empire Latin », regroupant l’Espagne — au modique prix de renverser Franco — , le Portugal, l’Italie et la France, une sorte d’empire de la non-économie reposant, lui, sur une unité de mentalité caractérisée par « cet art des loisirs qui est la source de l’art en général, par l’aptitude à créer cette « douceur de vivre » qui n’a rien à voir avec le confort matériel, par ce « dolce farniente » même qui ne dégénère en simple paresse que s’il ne vient pas à la suite d’un travail productif et fécond […] Cette mentalité commune, qui implique un sens profond de la beauté associé généralement (et tout particulièrement en France) à un sentiment très marqué de la juste mesure, et qui permet ainsi de transformer en « douceur « aristocratique » de vivre, le simple bien-être bourgeois et d’élever souvent jusqu’à la joie, les plaisirs qui dans une autre ambiance seraient (et sont dans la plupart des cas) des plaisirs « vulgaires » […] car […] il faut bien admettre que c’est précisément à l’organisation et à l’« humanisation » de ses loisirs que l’humanité future devra consacrer ses efforts. » Il va même jusqu’à noter le caractère spontanément « municipal » du « Monde latin » et se réfère à la « Renaissance, qui est probablement la périodse historique latine par excellence. »
Si nous analysons la situation historique qui nous est faite à présent, il ne fait pas de doute que nous voilà pris à nouveau dans une configuration qui n’est pas sans rappeler celle de 1945. Une nouvelle guerre froide pour l’hégémonie mondiale a d’ores et déjà commencé : l’empire anglo-américain auquel l’Allemagne reste inféodée est aux prises avec l’empire chinois, dont la gouvernementalité « autoritaire » a au fond déjà remporté la mise symbolique. Les pays latins, sinon l’Europe en entier, ont complètement décroché sur le terrain où se livre la bataille : la technologie et la puissance économique — sans parler, évidemment, de la puissance militaire. Ils ne sont plus bons qu’à exporter des signes de distinction à destination des classes privilégiées du reste du monde : que ce soit par la production de produits AOC, d’articles de luxe, de belles voitures ou d’un tourisme raffiné venant épuiser les derniers gisements locaux d’« authenticité ». C’est ce formidable déclassement historique qu’ont révélé le mimétisme et l’impuissance arrogante de l’Europe face à la « crise du COVID ». Notre destin est, un peu comme l’Italie à la Renaissance, non seulement d’assister en spectateur à l’Histoire en train de se faire, mais de devenir le théâtre impuissant de l’affrontement entre les rapacités étrangères. Simple échiquier, alors, de la compétition entre la France, l’Espagne, l’Empire germanique et la papauté, l’Italie renaissante se trouvait dans une situation où « de l’extérieur on assumait pour elle l’indispensable rôle d’agent historique. Elle s’en trouvait à peu près déchargée. C’est pourquoi la politique devient pour elle un art. Elle fut la première à y appliquer sa réflexion. C’est qu’elle était relevée de la nécessité d’en faire […] Si bien que la « fin de l’histoire » socialiste, il n’est pas possible de ne pas lui donner les traits de la civilisation italienne » (Dionys Mascolo, Le communisme). Se retirant de la lutte historique, les cités italiennes avaient alors transposé la lutte sur le terrain de la beauté de la vie et des villes — c’est ce que Dionys Mascolo appelle le « socialisme esthétique », qui n’est pas par hasard un socialisme communal. La Renaissance, donc, comme produit de la désertion du vain affrontement entre les puissances historiques et comme revanche éclatante sur celles-ci.
Dit comme cela et transposé dans le contexte actuel, la proposition d’une nouvelle forme d’« empire latin » impulsé non depuis l’appareil d’État mais depuis les mondes subsistants et à naître — empire qui peut bien se jouer des frontières nationales au vu des quantités de tomates et de mozzarellas que l’on consomme d’ores et déjà à Berlin — pourrait ressembler à un programme de renoncement doublé d’un espoir de consolation revancharde. Il n’en est rien. Il y a une profondeur stratégique à ce possible dénouement historique, et qui fait de Yuk un précieux allié. Comme l’a amplement documenté Jean-Michel Valantin dans L’aigle, le dragon et la crise planétaire, l’anthropocène est un « champ de bataille sino-américain ». L’Amazonie brûle déjà de l’appétit chinois pour le soja transgénique brésilien. La fonte de l’Arctique constitue une bénédiction commerciale et un enjeu géostratégique avant d’être la cause du ralentissement un tout petit peu regrettable du Gulf Stream. La pression qu’exerce le chaos climatique mondial sur les productions agricoles est une variable dans l’affrontement que se livrent les états-majors militaires. Mais contrairement à la prospective de cet auteur, qui veut croire que l’intelligence artificielle généralisée, la transition numérique, le smart farming et les drones agricoles pourraient donner naissance à une « civilisation écologique », voire qu’à la fin, plutôt que de se livrer à une rivalité suicidaire, la Chine et les États-Unis vont se réconcilier pour sauver la planète, il est patent que le projet américano-chinois d’accélération va dans le mur. Sa seule raison d’être tient à ce que l’accélération est l’unique manière que connaissent les sociétés modernes pour stabiliser leur course insensée. L’accélération, tout comme la course internationale à la puissance, est d’abord à vocation intérieure. C’est ce que le géopoliticien est dressé à ne pas comprendre. Personne ne croit aux finalités alléguées : il s’agit seulement, pour tout ce qui gouverne, de maintenir le statu quo par le seul moyen possible — la fuite en avant. Aucun projet de géo-ingénierie ne viendra ralentir l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère. Aucune multinationale ne parviendra à nettoyer les océans moribonds afin de ripoliner son image après le dernier cataclysme industriel qu’elle aura causé. Si quelque dirigeant mondial fait un jour mine d’écouter feu Bruno Latour, ce sera simplement pour gagner un peu de temps, et donc un peu d’argent. Bill Gates ne sauvera ni l’Afrique ni a fortiori la planète. Le pétrole ne cédera de la place aux « énergies vertes » que pour ajouter aux marées noires la coupe rase de tout ce que le monde compte encore de forêts — pardon de « biomasse ». La poursuite de traces de vie extraterrestre ne s’arrêtera qu’avec les dernières traces de la vie terrestre elle-même, dont cette quête aura servi à détourner le regard de survivants gagnés par une incompréhensible inquiétude. L’agriculture de haute précision, ou de barbarie accomplie, ne renoncera à étendre son empire stérile pour rien au monde, et elle sera déclarée « biologique » de surcroît, tout comme on ne détruit à la pelle ce que le nord parisien contenait encore de banlieue à la Doisneau qu’au prétexte d’y construire des éco-quartiers et des buildings HQE — qui, d’ailleurs, resteront désespérément vides. Les éoliennes de deux cents mètres de haut ne font qu’étendre et décorer la monstruosité distribuée d’un réseau électrique qui ne renoncera ni au charbon ni au nucléaire. Chaque menée technologique pour remédier aux ravages du capitalisme ne fait qu’empiler de nouvelles contradictions indépassables aux anciennes. Il n’y a aucune âme raisonnable chez aucun prince de ce monde à qui adresser la supplique du ralentissement et de la résonance, ni aucune firme qui envisage de passer de la domination technologique aux cosmotechniques. Le ciel est d’ores et déjà si vide pour les métropolitains, qu’ils s’étonnent à peine d’y voir apparaître les éblouissants satellites d’Elon Musk. Pour prendre les choses sur leur versant « subjectif », on ne peut que se ranger à la prophétie de Lewis Mumford, vieille maintenant de soixante-dix ans : « Jamais auparavant l’homme n’a été aussi affranchi des contraintes imposées par la nature, mais jamais non plus il n’a été davantage victime de sa propre incapacité à développer dans leur plénitude ses traits spécifiquement humains ; dans une certaine mesure, comme je l’ai déjà suggéré, il a perdu le secret de son humanisation. Le stade extrême du rationalisme post-historique, nous pouvons le prédire avec certitude, poussera plus loin un paradoxe déjà visible : non seulement la vie elle-même échappe d’autant plus à la maîtrise de l’homme que les moyens de vivre deviennent automatiques, mais encore le produit ultime — l’homme lui-même — deviendra d’autant plus irrationnel que les méthodes de production se rationaliseront. En bref, le pouvoir et l’ordre, poussés à leur comble, se renversent en leur contraire : désorganisation, violence, aberration mentale, chaos subjectif. »
L’accélération en cours ne vise qu’à s’assurer une plus complète maîtrise, et un maillage plus moléculaire, de masses humaines toujours plus sujettes à la panique devant les effets du progrès ; il s’agit juste de resserrer les mailles du filet visant à retenir les déserteurs. C’est une course de vitesse qui oppose l’avancée de la catastrophe et la progression du contrôle
On dit le pouvoir compact du Parti communiste chinois plus à même d’opérer le nécessaire virage vert par ses moyens implacables que les déliquescentes démocraties libérales occidentales. N’importe quel observateur sérieux et renseigné ne constate en Chine comme ailleurs que des effets d’annonce autour de mirages volontaristes en forme d’avortements. L’accélération en cours ne vise qu’à s’assurer une plus complète maîtrise, et un maillage plus moléculaire, de masses humaines toujours plus sujettes à la panique devant les effets du progrès ; il s’agit juste de resserrer les mailles du filet visant à retenir les déserteurs. C’est une course de vitesse qui oppose l’avancée de la catastrophe et la progression du contrôle. Qu’importe le vainqueur : le train de la civilisation technologique continuera sa marche au gouffre à un rythme sans cesse plus terrifiant. Pas plus qu’il n’y a eu de « dépassement du nihilisme à travers le nihilisme », il n’y aura de victoire de la Chine sur l’Occident au moyen de la technologie occidentale. Comme le note si bien Yuk, la Chine est elle-même dépassée par les moyens qu’elle a employés — elle a été à son tour le jouet de ses propres instruments, et d’une ontologie aussi étrangère qu’hostile. Les films chinois contemporains ne cessent de témoigner de cette hébétude, de cet égarement existentiel et de ce sentiment d’aliénation sans remède. Les Chinois aussi, quelles que soient les reviviscences opportunes du confucianisme, du moïsme, du taoïsme ou du légisme, ont perdu le fil de leur propre tradition, à force de l’avoir piétinée. La seule chose qui caractérise le Chinois contemporain entre tous les autres Modernes, c’est une ardeur plus innocente à la mobilisation générale, une fringale de consommation moins exténuée et un orgueil national un peu plus profondément blessé, et donc un peu plus excitable, que celui de l’Américain moyen. Qu’est-ce qui pouvait naître d’autre qu’un coronavirus à diffusion mondiale d’une conurbation à l’entrée de laquelle trônent des affiches du Parti proclamant « Chaque jour, un nouveau Wuhan ! » ?
Si la course économique et technologique actuelle va droit dans le mur, alors il faut admettre que faire un pas en arrière pourrait signifier prendre plusieurs coups d’avance. Déserter le jeu toujours-déjà condamné des puissances pourrait inaugurer une nouvelle partie. S’arracher à la lutte historique pourrait être la seule façon de l’emporter sur une confrontation en elle-même perdante. Laissons la « ChineAmérique » à son triste destin ; elle se retournera bien assez tôt pour s’aviser que nous l’avons devancée dans la seule direction praticable, et heureuse. Tout indique, au reste, que les réserves d’invention les plus considérables, dans presque tous les domaines, ne tiennent pas à une débauche plus grande de moyens investis dans le paradigme mécaniste à bout de souffle de la modernité, mais dans la disposition à s’y soustraire et à expérimenter des hypothèses cosmotechniques jusqu’ici tenues pour farfelues. C’est là que la proposition de Yuk prend tout son sens, et mérite d’être prise très au sérieux par le lecteur français. Il se peut que ce soit à nous autres, tard venus d’un continent sur lequel le soleil ne cesse de décliner, de recueillir ce que la tradition taoïste a composé de plus vivifiant, de plus spirituel, de plus paracioxal. Il se peut qu’il nous appartienne de nous attacher nouvellement à la terre et au ciel de manière à cultiver une efficacité qui ne réside plus centralement dans les effets extérieurs, dans ce qui est produit, mais dans ce qui se produit — dans la dimension éthique, donc, et non intentionnelle. Il se peut que s’annonce là une forme de guérison aussi générale que notre amputation fut civilisationnelle. Il se peut que ces jeunes agronomes qui reprennent des fermes communales en circuit court plutôt que de devenir consultants en tours aéroponiques soient comme les oiseaux dont la fuite précipitée annonce l’orage, ou le tsunami. Il se peut que le seul avenir des ingénieurs réside dans le démantèlement du système industriel, tout comme le seul avenir de l’inciustrie nucléaire est le business du démantèlement des centrales — ou de la « gestion » des Fukushimas à venir. S’il y a une condition de « résilience » dans le chaos qui s’annonce, c’est bien de s’arracher aux grancis réseaux techniques, que ce soit pour la fourniture d’électricité, les communications ou la nourriture — de cesser d’en dépendre. quand bien même un continent entier s’engagerait dans la voie cosmotechnique, l’échelon communal resterait son chemin privilégié. La désindustrialisation de l’Europe n’est tenue pour une malédiction qu’en vertu du refus d’y voir la seule voie d’un avenir sensé. Ceux qui s’effraient, comme Frédéric Lordon, qu’en cas de sécession généralisée, ils devraient renoncer non seulement à leur ordinateur produit à Shenzhen mais en outre à leurs stylos en plastique venus d’Inde, manquent seulement d’aptitude à une pensée processuelle, et non programmatique. L’unification technologique du monde, qui sous-tend l’Empire et son homogénéité éthique, a atteint son point culminant ; d’où le vertige de celui qui envisage la possibilité d’un retour sur terre.
Simondon notait en son temps que « l’homme moderne dégrade en même temps, de la même façon, et pour la même raison, la technicité et la sacralité » ; il appelait à sauver l’objet technique de « son statut actuel qui est misérable et injuste », à le sauver, notamment, de son adultération commerciale. Pour lui, il y a une pluralité des technicités comme il y a une pluralité des sacralités. Sa pensée est folle, géniale, contradictoire, exploratoire. Par son extrême sensibilité, son appréhension relationnelle, organique, dynamique des phénomènes, elle épouse celle de Yuk. Elle appelle à un décrochage, à détourner le regard des buts agités dans le lointain vers l’immanence de chaque réalité technique. À extirper de leur invisibilité toutes ces infrastructures qui déterminent notre façon de vivre et aiment tant à se fondre dans le décor. Où que nous soyons, où que nous portions les yeux sur le monde qui nous entoure, nous nous trouvons confrontés aux aberrations qu’impose la logique économique — totalisation, contrôle, mesure, innovation, profit. C’est au fond la même urgence de revenir sur terre et de décrocher du cours dément de la civilisation qui impose de méditer, notion après notion, la métaphysique occidentale et de faire exploser, objet après objet, le continuum technologique. Il y a autant à découvrir dans l’archéologie du savoir que dans la généalogie des objets techniques qui nous environnent, autant de bifurcations à peine esquissées que condamnées par la « nécessité historique ». Et c’est au fond la même passion de comprendre comment cela fonctionne et à quel détournement d’usage cela pourraient donner lieu qui est à l’œuvre ici et là. Le partage entre utilité et beauté, entre technique et éthique, entre « règne de la nécessité » et « règne de la liberté », entre démarche individuelle et besoin collectif, perd ici tout son sens dès lors que l’on engage le processus depuis quelque part. Chacun sent bien que c’est ce que le présent réclame. Les flux de désertion ne cessent d’enfler à mesure que l’impasse se matérialise. Tout se joue, ici, dans le rapport au temps : « Si nous conservons au Temps sa valeur puritaine, c’est-à-dire une valeur d’usage, il faut alors se demander comment le temps est employé, ou comment il est exploité par les industries du loisir. Mais si la notion d’usage fonctionnel du temps devient moins prégnante, alors les hommes devront ré-apprendre certains des arts de vivre qui se sont perdus avec la révolution industrielle : comment remplir les failles de leurs journées avec des rapports personnels plus riches et plus détendus » (E.P. Thompson, « Temps, travail, capitalisme industriel »).
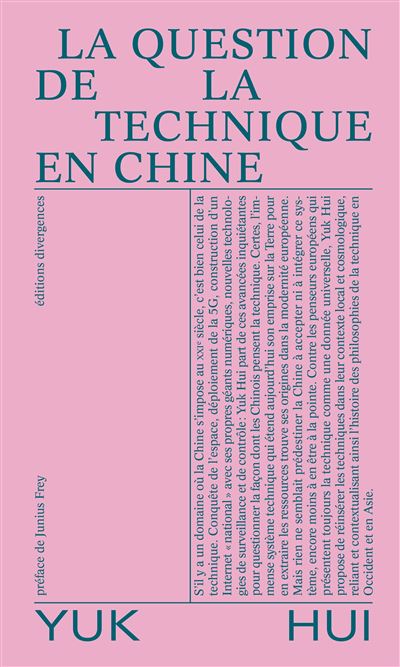
Yuk Hui
La question de la technique en Chine
Divergences, 2021.

