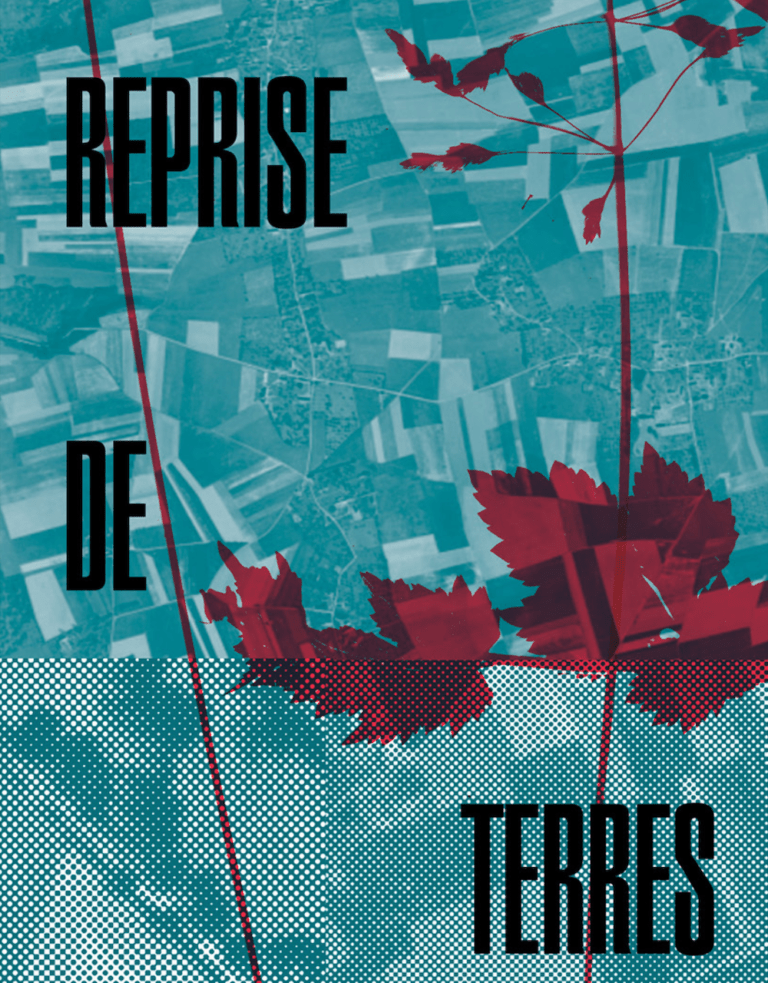Les jardins ouvriers d’Aubervilliers prolongent l’histoire maraîchère de la Seine-Saint-Denis : sept hectares ceinturant le Fort, riches de biodiversité, terres nourricières pour de nombreuses familles voisines. Des jardiniers et des jardinières les entretiennent toute l’année, y tissent des liens, s’entraident et comptent sur les fruits et légumes qui y poussent pour survivre. Mais Paris 2024 et ses « grands projets » l’entendent autrement ! Sont prévus, en lieu et place des jardins, une piscine olympiques et un solarium, une gare du Grand Paris Express et un quartier de bureaux et d’hôtels. Conséquence directe : 10 180 m² de jardins et 37 000 m² de bois sont menacés de disparition.
Pour les habitants d’Aubervilliers, la nécessité d’un équipement aquatique n’est pas remise en cause : il leur serait en effet bien agréable, et utile aux scolaires des environs. D’autant que le projet de piscine est prévu sur un parking, et n’impose pas la destruction des jardins. Mais comme souvent, c’est le gigantisme le problème : une piscine olympique est bien plus chère à construire et à entretenir qu’une piscine de quartier. Et pour rentabiliser l’équipement, ses promoteurs lui ont prévu une extension, le solarium donc, qui vient détruire les jardins. Cette aberration n’est que la suite d’une longue série : on déplore déjà l’artificialisation de toute l’ancienne Plaine des Vertus et on craint la destruction totale des jardins ouvriers d’Aubervilliers et de Pantin. Voilà pour le contexte.
Pour empêcher le désastre, une occupation du « jardin des vertus » à eu lieu, d’avril à septembre 2021. Que se joue-t-il, existentiellement et politiquement, dans l’occupation — même éphémère — d’un espace urbain menacé par la bétonisation ? Quels types d’attachements cela suscite-t-il ? Comment les pratiques d’écologie, a fortiori urbaines, impliquent-elles de ne pas quitter le sol sur lequel elles se tiennent — ce qui exige de se dégager de toute posture de surplomb ?
Autant de questions qui se sont posées au cours de notre discussion avec Jade Lindgaard et Dolores Mijatovic, toutes deux habitantes d’Aubervilliers, chacune à sa manière activiste pour la défense des jardins, et au-delà. Car le combat contre la gentrification et la bétonisation des quartiers populaires ne peut se faire aux dépends des pratiques de subsistance, de solidarités et d’entraide — de tous les « déjà-là » qui y ont cours. En ouvrant la brèche de l’écologie populaire, l’occupation des jardins ouvriers d’Aubervilliers a réussi à fédérer une multiplicité de pratiques, d’acteurs et de savoirs : de l’occupation aux recours juridiques, ou des manifestations aux liens avec ceux et celles qui cultivent la terre.
Mais, nous le verrons, cette lutte oblige aussi à réfléchir au dépassement de la question locale, et à mettre en place des outils de liaison pour fabriquer un réseau entre diverses expériences de défense, de préservation ou de reprise des terres. Et ce, que celles-ci se déploient en ville ou à la campagne.
Parades : Pour démarrer, on aurait aimé savoir comment s’est faite votre rencontre.
Jade Lindgaard : Alors attends, je crois que je me souviens… La mobilisation autour des jardins, elle fait suite à des prémisses de tentatives d’organisations de collectifs écologistes à Aubervilliers. Et donc on s’est rencontrées il y a quelques années dans Aubervilliers en transition, qui réunissait des personnes qui partageaient un souci écologiste autour du climat. Dans mon souvenir, en 2015, la COP21 a mis en mouvement plein de gens — et notamment en Seine-Saint-Denis. De mon côté, avec des amis, on a organisé pendant des mois des ToxicTours. C’était avec Émilie Hache, Mathieu Glaymann, et d’autres qui habitaient le département. Le principe, c’était d’organiser des visites guidées des lieux de Seine-Saint-Denis qui étaient fortement impactés par la pollution et potentiellement par les effets du changement climatique. A priori, les visites étaient prévues pour des personnes extérieures, pour expliquer ce qu’il se passait localement et pourquoi la question climatique était une question de justice sociale. On s’inspirait d’une forme d’activisme de rue qui existe aux États-Unis depuis les années 80, beaucoup pratiquée dans les mouvements de justice environnementale — qui héritent du mouvement des droits civiques, et qui luttent contre le fait qu’aux États-Unis, c’est dans les quartiers où vivent les personnes racisées, noires et d’origine latino-américaine, qu’il y a le plus de sites toxiques et de pollution. Contre la distribution raciale des inégalités environnementales. L’objectif était de rendre visible cette injustice à la population et aux pouvoirs publics. Donc nous, on a importé ça, de manière plus light — c’était moins attaché à des revendications, plus en mode « venez voir comment on vit dans le 93, à deux pas de là où se tiendra la conférence climat ». Ça, c’était les Toxic Tours. La motivation venait du fait qu’à ce moment-là, plein de collectifs, de festivals, de rencontres étaient organisés autour du souci climatique — c’est un moment clé je pense. Et suite à ça, à Aubervilliers, en 2016, s’est donc monté Aubervilliers en transition, collectif dont l’objectif était d’imaginer pour la ville une politique qui réduise les émissions de gaz à effet de serre, tout en correspondant aux besoins des gens. Un truc très programmatique. Ça a plus ou moins capoté — la personne motrice de ce collectif a rejoint la liste de la maire sortante dont le mandat ne s’était pas du tout soucié d’écologie, mandat qui avait même été assez conflictuel et violent. Mais c’est là que nous nous sommes rencontrées, Dolores et moi, et pas mal de gens aussi ! À une réunion de ce collectif.
Dolores Mijatovic : Ah ouais ? Je me souvenais plus…
JL : Ce qui est intéressant dans cette histoire, c’est que c’est un exemple d’énergie citoyenne réformiste mais motivée qui s’est heurtée à la question de l’exercice du pouvoir. La question de participer ou pas aux instances de pouvoir n’avait pas été mûrie par le collectif. Ça s’est décidé chacun dans son coin. Et donc, une personne, toute seule, a fait le pari — qu’on peut trouver légitime — qu’il fallait prendre le pouvoir pour changer les choses. Bon, ça s’est mal passé. Ce qui est marrant, c’est de voir que tout ce qu’il se passera ensuite à Aubervilliers, avec la lutte des jardins et tout, c’est le scénario alternatif : l’énergie contestataire des habitants, et non pas la volonté de prendre le pouvoir… Enfin c’est intéressant. Pour ma part, l’hypothèse politique que je porte, à la suite de Erik Olin Wright, pour changer radicalement la société, c’est qu’il faut tout essayer, agir à tous les niveaux, partout — dans la rue, dans le jardin, avec les gens, dans les écoles, les centres sociaux, et dans les institutions. C’était pas du tout ce que portait cette personne qui a fini en campagne pour la mairie — et a perdu l’élection d’ailleurs…
DM : Pour ma part, ça faisait longtemps que je connaissais une partie des personnes d’Aubervilliers en transition. Je vis ici depuis vingt-six ans. On avait déjà tenté des trucs avec certains : la première AMAP de la ville, une association pour proposer des « alternatives »…
Est-ce que toi, Dolores, tu as pu voir la métamorphose qui s’est opérée sur le territoire, entre l’époque du communisme municipal de Seine-Saint-Denis — qui avait la main sur plein de trucs — et sa disparition complète, ces dernières années ? Notamment au niveau du maillage institutionnel. Et du passage d’un rapport à la « classe ouvrière » entretenu par le parti, à quelque chose d’autre actuellement… Mais quoi ? Après tout Aubervilliers, historiquement, est une des villes les plus prolétaires, et parmi les plus pauvres, de la Seine-Saint-Denis.
DM : J’ai bossé à Romainville, à Noisy-le-Sec, et au Conseil départemental, quand c’était encore communiste. Je les trouvais très loin de tout ce qui était écologiste bien sûr, et pas si proches des « milieux populaires ». En Seine-Saint-Denis, il y avait une forme d’autocratie communiste. Ils étaient élus de père en fils, c’était un peu des dynasties… bon, ils se sont autodétruits en faisant ça.
JL : En Seine-Saint-Denis, les gens ne votent plus ! Aubervilliers est une ville de près de 90 000 habitants et la maire actuelle (UDI) est élue avec moins de 5000 voix en 2020. Mis à part les vieux militants communistes, personne ne vote plus pour le PC. La majorité des gens ne sont pas représentés, ne sont pas dans un rapport d’affiliation politique… la politique se passe ailleurs — et pas non plus dans les cercles alternatifs écolos auxquels nous participons ! Certes ces cercles sont vivaces, vivants, résilients… on l’a vu pendant le confinement ! Ces réseaux ont été hyper actifs dans la mise en place de la solidarité qu’on a pu constater à ce moment-là. Notamment autour de La Pépinière, des habitants se sont mobilisés pour distribuer de la bouffe ; d’autres ont livré des pommes et des poires aux pieds de tours HLM… La Pépinière, c’est une association d’Aubervilliers qui s’est constituée il y a quelques années avec ces nouveaux habitants de la ville. Caricaturalement, on les qualifierait de « bobos ». Moi je déteste cette expression, elle est mensongère ! En gros, des habitants d’une trentaine d’années à la culture écolo, avec des enfants jeunes, ou sur le point d’avoir des enfants, peu investis politiquement. Mais avec une fibre écolo, et humaniste. Et donc, La Pépinière s’est constituée autour d’un projet d’éducation populaire à propos de la bouffe. Ce que je trouve intéressant, c’est que les activités se sont développées dans un lieu qui s’appelle la ferme Mazier, dernier bâtiment qui témoigne de l’activité de production de légumes de son quartier. La ferme a été en activité jusqu’au début des années 1980, et possède encore un ancien four à betteraves. La Pépinière a repéré l’existence de ce four et a cherché à en faire un four communal. Idée profondément communiste ! La mairie PCF pourtant n’a eu de cesse de leur mettre des bâtons dans les roues, et La Pépinière s’est concentrée sur d’autres activités. Au début du premier confinement, en mars 2020, c’est pourtant des gens qui travaillaient au département qui ont contacté l’association — bien au courant et intégrée dans les réseaux d’alimentation en Île-de-France — pour distribuer des centaines de plateaux repas, car les services sociaux à l’arrêt ne pouvaient plus le faire. Un réseau de distribution à vélo a été mis en place — pour les migrants qui vivaient le long du canal ; le CCAS a fourni des listes de familles d’Aubervilliers à livrer… il y avait une incessante activité, complètement auto-organisée ! Ce qui était fascinant, c’est aussi que toute une partie de l’espèce d’underground social de la ville — beaucoup de gens ne sont déclarés nulle part, se logent grâce aux réseaux de débrouille, sont clandestins, etc. — a été soutenu de cette manière, par les plateaux et par la récup’ de La Pépinière. Ça s’est branché avec les brigades de solidarité populaire qui s’étaient constituées dans d’autres quartiers. Et en un an, à partir des réseaux qui préexistaient, le confinement a produit une montée en puissance. C’est comme si le confinement avait « reterritorialisé » plein de gens, qui se sont rendus compte d’un coup de la misère voisine quoi. En tous cas, ça a donné de la force à des réseaux, plus ou moins alternatifs, qui sont encore actifs aujourd’hui, et qui, d’une certaine manière ont un peu ouvert la voie à la lutte des jardins d’Aubervilliers. Bon, ça reste une tout petite minorité des habitants, pour reprendre votre question !

Pourtant, à un moment, le sentiment d’urgence — cette entraide qui provient de l’intensité affective et qui nous fait nous rappeler qu’on n’est pas seulement des larbins enfermés dans nos maisons par la police — il s’estompe. Et alors, les collectifs perdent cette énergie. Les affects partagés, qui produisent quelque chose de très impressionnant, d’un coup ne tiennent plus, dans la situation de « normalité »… ça explique aussi le slogan « pas de retour à la normale ».
JL : L’appel contre la réintoxication du monde va dans ce sens-là ! Oui, pour moi c’est complètement lié avec la lutte des jardins. La distribution assidue des plateaux repas, ça a dû durer un mois, car assez rapidement les services sociaux se sont remis en route. Et puis, des questions politiques ont commencé à se poser : allait-on devenir des humanitaires, ou bien les relais de la politique sociale du 93 ? Par contre, ça a donné naissance à des discussions, ça a ouvert une conscience collective assez forte. Ça nous a mis sur la voie d’acheter collectivement des terres à Aubervilliers. Des terres pour Auber, un collectif pour acquérir collectivement du foncier pour les habitants, c’est vraiment parti de l’expérience du confinement ! La Pépinière a continué les récup’, des mamans du quartier qui avaient reçu les plateaux repas sont venues cuisiner sur place. Toutes ces personnes, par ce maillage, ont été particulièrement réceptives à l’appel contre la réintoxication du monde qui émane, en juin 2020, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et qui appelle à se mobiliser partout en France pour que le système ne redémarre pas comme avant. Assez vite, la question s’est posée pour nous : ce serait quoi, à Aubervilliers, agir contre la réintoxication ? Et aussi vite la réponse : défendre les jardins ouvriers ! Pour ma part, je ne connaissais pas les jardins — j’habite à Aubervilliers depuis 14 ans et n’y étais jamais allée —, mais j’étais vaguement au courant par un ami, Ziad Maalouf, journaliste et habitant de la ville, que des jardins devaient être détruits — mais pas que c’était du fait de la construction d’une piscine olympique des JO de Paris 2024, on pensait que c’était à cause du métro. Donc moi, je rejoins l’aventure en juin 2020, à la fin de cette séquence de confinement et portée par l’appel contre la réintoxication du monde. Mais Dolores, toi, tu avais commencé à jardiner pendant le confinement…
DM : En fin de confinement oui ! Je n’avais pas de parcelle, en fait c’est Ziad qui m’a proposé de venir jardiner sur sa parcelle, dans le « jardin des Vertus ». Il est un peu confidentiel ce jardin — pas de site internet, pas vraiment d’indication. En fait il y a deux jardins contigus. C’est le même espace végétal, mais c’est coupé en deux : du côté Aubervilliers, les jardins ouvriers dits « des Vertus » ; du côté Pantin, les jardins familiaux. Le lieu est magnifique ! On m’avait fait un tableau plutôt négatif des jardiniers : machos, sexistes, racistes, alcooliques… très « vieille école » : pour demander à s’occuper d’une parcelle, tu dois faire un écrit, puis t’es reçue pour un entretien avec quelques jardiniers. Qu’est-ce que tu viens faire ici ? Qu’est ce que tu vas planter ? Etc. Bon, pour ma part, j’ai pas eu à passer par là, puisque je suis venue jardiner sur la parcelle de Ziad. Et c’était super ! Il n’y pas de séparation entre les jardins, quand tu jardines, tu vois les autres travailler, il n’y pas de palissade comme parfois. Dès juin 2020, on me parle de la destruction du jardin — moi je savais rien de cette histoire — et qu’il va peut-être falloir se mobiliser. Donc, on commence, on fait ateliers avec les jardiniers, on fait des banderoles, on démêle un peu ce qu’a dit la municipalité aux jardiniers — car elle leur a menti en leur affirmant d’abord que jamais on ne toucherait aux jardins, et ensuite, qu’ils serviraient seulement de stockage de gravats pour le chantier d’une gare du Grand Paris. La première mobilisation c’est ça : on ne veut pas de gravats sur les jardins. En juillet, on récupère les documents officiels du PLUI1, changé juste avant le confinement, et on se rend compte que les jardins sont devenus constructibles, qu’un projet urbain est prévu à leur endroit. Là, on est un peu tombé de l’armoire, si vous voulez. Finalement, ce sera pas des gravats, mais un solarium ; finalement, ce sera pas temporaire, mais définitif. On a alors été quelques uns à se réunir sur la parcelle de mon ami…
JL : La parcelle de la lutte !
DM : La parcelle de la lutte oui, c’est comme ça qu’on l’appelle maintenant ! Elle faisait pas partie du périmètre promis à la destruction, et pour l’instant elle a survécu. On a fait des réunions pendant l’été. C’est là que Jade nous a rejoints, avec Ivan Fouquet, architecte qui avait participé à la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Il a été très important, en termes d’analyse des documents. Il faut savoir le lire, hein, le permis de construire !
JL : C’est une connaissance technique particulière oui. Ivan avait participé, sur la ZAD à un truc qui s’appelait l’« atelier citoyen », sorte de contre-expertise du projet d’aéroport, à propos du trafic aérien, ou de la possibilité de rénover l’aéroport de Nantes, etc. Un truc à la fois hyper technique et hyper politique. Moi, ces documents je m’en souvenais bien, je les utilisais pas mal pour faire des articles à l’époque. Et donc, j’ai pensé qu’on pourrait peut-être les prendre pour modèle et faire l’« atelier citoyen des jardins d’Aubervilliers » !
DM : Nous sommes donc cinq ou six personnes à nous réunir dans cette perspective. Très vite les brigades de solidarité populaire nous rejoignent, et dès septembre, on se dit qu’on va résister à ce projet — sans savoir trop comment. On écrit donc à l’asso qui gère les jardins, au président, à différentes personnes, et on reçoit des réponses très ironiques, très méprisantes. On ne comprend rien à cette réaction ! On réaffirme notre souhait de lutter, mais l’asso des jardins refuse. Il faut dire pour être complet, même si on ne le savait pas à l’époque, que le président écrit dans Riposte laïque ((Revue en ligne, proche de l’extrême-droite, ouvertement islamophobe.)). Et on ne l’apprendra que plus tard, mais en parallèle, l’association affirme être « partenaire » de Grand Paris Aménagement, dans une position d’accompagnement de la destruction.
JL : Il faut ajouter aussi que Grand Paris Aménagement, c’est l’établissement public propriétaire des jardins — il y a donc une convention avec l’association des jardins —, et par ailleurs aménageur du projet du Grand Paris, notamment de l’éco-quartier du fort d’Aubervilliers, auquel est très liée la destruction des jardins, parce que les équipements qui sont prévus sur la zone (la piscine et la gare) doivent servir aux futurs habitants de ce quartier.
DM : Équipements qui sont déjà valorisés par les promoteurs quand ils vendent les logements sur plan ! Je reprends sur l’histoire du collectif. Il y avait des jardiniers dans ce collectif — un certain nombre, mais pas une majorité. On peut diviser les jardiniers en trois groupes : le premier, très militant, très actif avec nous ; le second, le gros des troupes, composé de personnes un peu plus âgées, qui soutenaient la lutte, mais qui étaient très défaitistes et assez peu actives, qui regardaient de loin avec bienveillance et inquiétude ; et le troisième, celui du président, minoritaire, très opposé à nos actions, qui n’y voyait que de la gêne, qui avait l’impression qu’on saccageait les jardins, qu’on les vendait aux journalistes, etc. Mais assez vite, on a compris qu’on ne pourrait pas se contenter des jardiniers, dans cette lutte, que nous n’étions pas assez nombreux, qu’il faudrait qu’on s’ouvre à l’extérieur, qu’on fasse connaître le projet et qu’on ouvre les jardins, qu’on les fasse visiter. Et beaucoup de gens du collectif vont arriver par ce biais là, les visites hebdomadaires. Des gens du voisinage, beaucoup ! On a aussi reçu des étudiants, des collégiens, on a eu beaucoup de demandes d’écoles pour venir visiter oui… Du fait de la communication ! Ziad écrit une tribune à la rentrée 20202. Le Monde la refuse, Libération l’accepte. Puis, une journaliste vient sur place et publie un très bel article sur les jardins. Et puis ça a continué comme ça : l’impact médiatique de la destruction de cet espace magnifique a été important, ça a beaucoup touché. Tout ce processus, ça a fait bouger certains jardiniers aussi. Certains qui étaient contre nos actions, ou qui, convaincus qu’on allait perdre, préféraient se résigner ; certains qui voyaient d’un mauvais œil l’action de « ces écolos bobos qui nous font chier »… J’ai l’impression qu’il y a des points de bascule. Par exemple la manif du 17 avril 20213 a changé pas mal de choses, on a eu des échos comme quoi des jardiniers sceptiques avaient été convaincus par ce moment-là, les prises de paroles, le monde présent, etc. Personnellement, j’ai pu le remarquer aussi, certains sont venus me remercier à ce moment-là, me dire « qu’il ne fallait pas lâcher ». Voilà pour le versant mobilisation quoi. On a fait beaucoup d’écrits ; des pancartes ; on s’est interposé quand l’aménageur a voulu distribuer un protocole à tous les jardiniers ; on est allé je sais pas combien de fois discuter avec les jardiniers ; on a été pourrir des réunions de Grand Paris Aménagement, empêché la tenue des réunions d’installation du chantier… On a aussi été dans les Courtillières4, distribuer des textes et des produits des jardins ; on a collé énormément d’affiches… Parallèlement à tout ça, on a entamé des démarches juridiques. Avec un premier avocat — ça s’est mal passé – ; puis avec un second, militant, avec qui on a fait un recours contentieux au PLUI. Bon. À un moment, on était un certain nombre à penser qu’on n’y arriverait pas avec le juridique et le médiatique, que ça suffirait pas, et qu’il faudrait qu’on aille dans quelque chose de physique. Une occupation. Un mois avant la manif du 17 avril, il y a eu une réunion exceptionnelle pour préparer la manif et pour commencer à parler d’occupation. J’ai contacté des gens que je connaissais, qui avaient occupé le triangle de Gonesse en y créant une ZAD, début 2021, notamment ; on a fait appel à un avocat qui a achevé de nous convaincre. C’était la première fois qu’il venait au jardin et il nous a dit : « on ne gagne rien avec le juridique, il vous faudra occuper à un moment ou à un autre ». Donc c’était parti. On a occupé quatre mois. Le premier, il s’agissait de préparer et d’organiser le lieu pour pouvoir y vivre, puis il y a eu trois mois d’occupation véritable. On a lancé cette occupation parce que la convention entre Grand Paris Aménagement et l’association prenait fin au 30 avril, et qu’on craignait que tout soit clôturé dès le 1er mai. Donc, on était un certain nombre à y dormir de manière secrète début avril ; il y a ensuite eu la manif ; et le week-end suivant, nous construisions un mur de paille. 5 heures du matin, deux semi-remorques chargés de paille arrivent de banlieue, nous sommes une cinquantaine à les attendre pour transporter les bottes et, avec l’aide d’un collectif d’architectes qui travaille la paille — le « collectif paille » —, on a passé le week-end à construire en utilisant la terre des jardins… c’était fantastique !
JL : La jonction archis alternatifs / habitants / militants… il y a eu un truc hyper beau !
DM : De nouveau, on a eu une grosse couverture médiatique. « C’est la terre des jardins qui se défend ! ». On construit, le week-end suivant on continue, et celui d’après, c’est le week-end du 1er mai. Il se trouve qu’à ce moment il y a une manif au triangle de Gonesse. J’y vais, et le lendemain, quand je reviens aux jardins, quelqu’un me dit qu’un mec est passé, un huissier du Grand Paris Aménagement qui venait constater que les parcelles n’avaient pas été libérées, qu’elles restaient occupées. Le tribunal de proximité d’Aubervilliers, à la fin du mois de mai, assigne l’asso des Vertus parce qu’elle n’a pas libéré les parcelles. On contacte notre avocat, qui est furieux — il ne s’y attendait pas, on pensait que ce serait le collectif, ou les personnes qui s’étaient déclarées habitantes qui seraient assignées, pas l’association. Mais le tribunal assigne des gens qui ne sont pas les occupants ! On décide rapidement de communiquer sur le fait qu’on nous invisibilise et de nous déclarer auprès de la préfecture, de la police et de GPA comme occupants — on est deux à se domicilier aux jardins. Statu quo, on ne nous évacue pas. On est déjà bien installé sur ce qu’on appelle désormais la JAD (Jardins à défendre). On reçoit des classes par dizaines — je jour où la sous-préfète vient avec les RG, il y a cinquante gamins d’une école maternelle qui passent et qui la saluent… situation proprement surréaliste ! On continue à aménager la JAD, dans un modèle très respectueux de toutes les différences, avec des espaces dédiés, non-mixtes, des questionnements sur le véganisme… Bon, moi, au départ, j’ai eu du mal avec ça. J’ai beaucoup discuté avec des jeunes militants, pour essayer de comprendre. J’ai bougé, moi aussi ! Sur ces sujets notamment. On en a beaucoup discuté, et maintenant, je trouve que ces revendications sont légitimes, bien sûr. Et puis, il y a tout ce qu’implique l’autogestion, toutes ces réunions, où certains s’écoutent parler, pendant des heures… Moi, au bout de deux mois sur la JAD, j’ai un peu pété un câble. Une histoire de rats ! Je me suis retrouvée une nuit avec plein de rats dans ma cabane, et c’était trop, cette fois-ci… Ce sont les rats qui m’ont fait rentrer chez moi ! C’est à ce moment-là que j’ai appris qu’en 68 ce ne sont pas les CRS qui ont délogé les étudiants de la Sorbonne, ce sont les rats. Bon… à part ça, c’était une aventure incroyable, des rencontres formidables qui n’auraient jamais dû avoir lieu ! La JAD c’était un espace de liberté, un espace où plein de luttes se sont exprimées, où il y a eu des débats, des films, etc. Un rituel d’Amérique du Sud aussi, organisé par une femme de l’isthme de Tehuantepec, un truc impressionnant ! Comme j’ai une voiture, j’ai aussi fait beaucoup de récup’ de bois, j’ai passé tout un moment de ma vie à transporter du bois, pour alimenter la JAD ! À un moment, la vie du lieu a pris tellement d’importance, elle demandait tellement d’énergie, qu’on ne faisait plus du tout ce qu’on faisait avant l’occupation, c’est-à-dire distribuer les légumes et les herbes du jardin, discuter avec les habitants, communiquer sur la lutte, etc. On a repris ces activités donc, mais c’est là que tu te rends compte que ça te prend ta vie entière, des expériences comme celles-ci !

Pourrais-tu nous raconter comment s’est déroulée l’évacuation, nous parler de son impact sur la lutte ? Et sur le plan juridique, où en est-on ?
DM : L’évacuation a eu lieu le 2 septembre. La veille au soir, nous avions une AG et nous étions hyper optimistes, parce que notre avocat avait déposé deux jours plus tôt une demande d’annulation du permis de construire, ainsi qu’un référé concernant l’arrêt des travaux — ce qui est une procédure d’urgence. Mais le lendemain donc, très tôt, des cars de CRS sont arrivés, et ça a été réglé en dix minutes. L’équipe qui faisait la vigie les a vus, elle est venue taper aux portes des tentes et des cabanes, mais il n’y a pas eu la résistance que les occupants avaient prévue. Moi, j’étais pas là, je revenais juste de Notre-Dame-des-Landes, j’étais restée chez moi la veille. Ça a été très violent de voir la destruction, l’énorme tractopelle à l’œuvre, qui détruit en quelques secondes les murs et les cabanes qu’on avait construites. De voir à quelle vitesse il faisait disparaître les traces, comme s’il fallait que rien ne reste, ni matériel, ni images — des flics et des vigiles empêchaient les médias d’accéder aux jardins. Ça a été trop difficile, pour moi, de partir, et dès le soir même, je me suis installée sur un matelas gonflable derrière le grillage… on est resté là pendant 18 jours. La JAD 2, c’était extrême ! Contrôle d’identité tous les jours ! Un militant a eu une friction avec un vigile, la police est violemment intervenue et l’a placé en garde-à-vue : il est interdit de séjour à Aubervilliers en attendant son jugement, en novembre. Il y a eu des frictions au sein du collectif : certains nous reprochaient d’être trop dans l’émotion… Mais bien sûr ! Tout ce qu’on a fait, c’est que de l’émotion ! L’occupation a donc un peu continué, mais on était très peu, deux ou trois personnes seulement parfois… j’ai même passé certaines nuits toute seule, dans les deniers jours. J’ai l’impression que les 18 jours passés là, notamment les deux premiers, ont été très violents… Le lendemain de l’évacuation — il faisait très chaud ce jour-là —, des flics se sont mis à l’ombre, sous un barnum, alors qu’autour tout était détruit. Je m’avance, et quelque chose a pété dans ma tête : je me suis mise à hurler sur les flics, leur disant que c’était mon barnum, que je ne les autorisais pas à être là. J’ai hurlé, c’était glaçant — il y avait les ouvriers, des gens de la Préfecture et du Grand Paris Aménagement, et donc ces flics. Les flics ont quitté le barnum, et se sont mis sous un arbre, et de nouveau — cette fois d’autres avec moi — on leur a hurlé dessus en leur disant que c’était un des deux derniers arbres… et les flics sont partis. Dans les 48 premières heures, après l’expulsion, j’ai des trous, je sais plus ce que j’ai fait… c’était vraiment un traumatisme de voir tous ces arbres arrachés, toutes ces cabanes, toutes ces cultures… On m’avait prévenue, qu’il fallait que je me prépare… mais comment peut-on se préparer à ça ? Il m’a fallu rester là, tout ce temps, pour digérer. Et au bout d’une quinzaine de jours, il y a eu l’audience en référé du recours déposé contre le permis de construire de la piscine, à la cour administrative d’appel de Paris. Je m’étais dit que si on obtenait la suspension du permis de construire de la piscine, je démonterais le campement de la JAD 2. C’est ce qu’il s’est passé ! Ils venaient juste de commencer à faire des trous, sur le site du chantier ! On était paniqué, on est allé hurler au gars dans la machine qui faisait les trous qu’on avait gagné, que les travaux étaient suspendus, qu’il fallait qu’il arrête les trous ! Ça s’est arrêté. Mais que le lendemain : on a mis une journée à les arrêter vraiment… Pendant tout le temps de la destruction, on aura eu, les uns et les autres, des discussions avec des gens qui travaillaient sur le chantier — un vigile, des ouvriers, même des flics — qui trouvaient ça dégueulasse, ce projet de piscine, la destruction des jardins. Tout le monde est d’accord que c’est dégueulasse, et tout le monde se cache derrière le « je n’y peux rien » ! La suspension, c’est une première victoire. Il va y avoir un jugement sur le fond, dans trois à cinq mois, et qui potentiellement pourrait annuler le permis de construire. Tiens, il y a quelques jours, je suis tombée sur un terrible reportage sur l’Amazonie. Tu y vois un type qui a des milliers et des milliers d’hectares, plein de bœufs dessus, et en plein milieu, il y a une bande de forêt — pas très grande, un kilomètre sur cinq cent mètres quoi. Le journaliste lui demande de quoi il s’agit, et le type répond qu’il a un petit fils et qu’il lui garde un morceau de forêt pour qu’il puisse voir ce que c’est… bah tu vois, c’est ce qu’ils ont envie de faire chez nous ! En détruire le maximum et en garder un petit peu, qu’on pourra regarder, de la promenade de l’écoquartier, en haut du fort… et tant pis pour les renards, le vingt-deux espèces d’oiseaux protégées, les grillons d’Italie, les hérissons… on a pourtant appuyé là-dessus, sur la biodiversité des jardins dans la contestation du PLUI, mais bon, ils s’en foutent, ça les arrête pas !
Ça fait écho, ce que tu racontes sur la prise en compte de l’écosystème, à ce que Rancière disait récemment dans une discussion qui a eu lieu aux Murs-à-pêche5 de Montreuil. Pour lui, la question des luttes écologiques est en partie minée par la logique d’expertise. Là où des experts s’arrogent un rôle de représentants de ce qu’on peut appeler les non-humains. Il s’en suit la restauration, par là, d’une sorte de scène de la dépossession politique.
JL : Si Rancière dit que la protection de la nature dépend des experts, alors je suis pas du tout d’accord avec lui. Enfin, je veux dire, c’est méconnaître à quel point la connaissance de la nature est un savoir populaire ! Un savoir partagé par un très grand nombre de personnes, un savoir aujourd’hui en pleine reconstitution. Le clivage experts-profanes ne marche pas du tout, s’agissant du rapport à la nature ! C’est une connaissance mésestimée par tout le monde, par le monde institutionnel de l’écologie bien sûr, mais aussi par la gauche contestataire, même la plus radicale. Mais il faut comprendre comment ça marche en France : depuis quarante ans et le développement du droit de l’environnement, il y a énormément d’instances de savoir scientifique sur l’environnement. Elles n’ont aucun pouvoir, elles sont seulement consultatives — elles restent cependant super utiles : il y a dedans des personnes qui profitent du fait que toute une série de projets d’aménagement passent sous leurs yeux pour les partager à des associations, des journalistes, etc. C’est un garde-fou assez important, s’agissant de la protection de la nature. Pour autant, ces institutions ne prennent pas en compte le savoir des gens… Ce que je veux dire, c’est qu’il y a dans ce savoir un potentiel politique énorme ! Et je trouve que ce qui intéressant dans cette discussion sur l’expertise, c’est de se rendre compte qu’il y a tout un espace qui est hyper vivant et hyper populaire qu’on ne considère vraiment pas à sa juste valeur ! Il y a là de quoi nourrir des formes de résistance politique à l’aménagement et à la destruction des espaces naturels. De la même manière qu’il y a l’ « atelier citoyen » de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une expertise naturaliste populaire et partagée — et pour garder cet exemple, dans la lutte contre l’aéroport, les naturalistes en lutte, qui étaient justement des spécialistes des serpents, des insectes, des oiseaux, des zones humides, etc., ils ont été des acteurs décisifs : ils ont observé et cartographié la ZAD mètre carré par mètre carré, et ces inventaires ont servi aux recours juridiques, qui ont permis que la lutte dure.
Un autre exemple. Touchant, pathétique, et drôlement intéressant. Ça se passe en Brière, il y a peu. Des marais, gigantesques, pas loin de Saint-Nazaire — des milliers d’hectares de marais ! C’est magnifique. Mais c’est un écosystème moribond. Et là, on se retrouve avec un vieux naturaliste, un enfant du pays, extrêmement savant. Et complètement accablé… Un des trucs qui le rend toujours fou c’est la classification en Parc naturel de 1970 ! Parce que le marais de Brière, ce sont encore des communaux : ça n’appartient ni aux communes administratives, ni à l’État, ni à aux particuliers, mais aux habitants. Les marais ont été pendant des siècles définis par des usages ; disparates (extraction de tourbe, pêche, chasse, pâturages sans clôtures…). Il n’y avait pas d’instance administrative pour « gérer » cet espace, jusqu’à l’arrivée du parc naturel : et le type — je pense que c’est un vieux communiste comme il en existait, dans les Chantiers de Saint-Nazaire, plutôt communiste-libertaire — ça l’avait désespéré. Pour lui, le parc naturel, c’était la fin des usages populaires, c’est l’avènement du royaume des experts et de ses pantins — les élus, des représentants du syndicat d’initiative, etc. Une division radicale, pour le coup, d’avec des sphères « autorisées », expertes en ceci et en cela et des élus (qui souvent n’y connaissent rien, nous faisait-il remarquer). Le label Parc naturel, en rendant cet espace « protégé » fut une manière d’acter la fin des communaux qui avaient pu perdurer jusqu’aux années 60.
JL : On est au cœur des questionnements qui animent Reprise de terres, on a tout un chantier qui est là-dessus. Au-delà de la question de l’expertise : comment reprendre des terres pour les déprendre ? Ça pose la question de la cohabitation avec du sauvage ! C’est la tension, qui est au cœur de l’écologie aujourd’hui, entre préservation nécessaire d’espaces sauvages et maintien de la possibilité des usages de ces espaces. Et s’agissant d’espaces dits « sauvages » — les forêts, les marécages, les zones humides —, les usages qui y ont cours sont des usages populaires ! C’est un des cœurs de la contradiction entre écologie et pratiques populaires : le discours de l’écologie quand il est abstrait et qu’il se pose quelque part, s’il ne pense pas, en même temps et avec la même intensité la protection du sauvage et la présence humaine — la question sociale, les usages, en terme de subsistance notamment, des personnes qui tirent leur existence de l’utilisation de cet espace sauvage — et bien forcément, il est perçu comme technocratique, arrogant, dominateur. Et bon… le rapport est peut-être un peu téléphoné, mais c’est pour moi la même chose qui se joue s’agissant de l’écologie dans les quartiers populaires. C’est fondamental. Pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi est-ce que dans la lutte des jardins des Vertus, il y a aussi peu d’habitantes et d’habitants d’Aubervilliers ? — d’habitants des Courtillières, qui sont pourtant les jardiniers ! Il y en a bien sûr, mais une petite minorité ! On ne peut pas dire que le quartier des Courtillières se soit mobilisé pour les jardins, pour le formuler de manière plus exacte. Idem : je n’ai vu personne de mon quartier dans les manifs ! Il y a donc comme un obstacle entre le fait de vivre dans un quartier populaire et le fait de défendre quelque chose qui a trait à l’écologie. C’est très intéressant !
Sur un plan plus général, on pourrait convoquer les travaux de Flaminia Paddeu6, et se poser la question de comment, dans le cadre de luttes locales comme celle-ci, ne pas devenir des « pédagogues », des éclaireurs des consciences, etc ? Comment ne pas être hors-sol quoi… pas spécialement dans le cadre des jardins des Vertus, ce sont des questions qui se posent à nous tous. Partout.
JL : Je pense qu’il faudrait qu’on travaille là-dessus, toujours, quand on est dans un combat écolo. C’est un tout petit peu ce qu’on a commencé à faire avec Reprise de terres et c’est ce qu’on essaye de poser comme cadre de discussion avec les « Rencontres des espaces d’écologie populaire », un réseau de rencontres monté début 2021 entre des personnes qui jardinent, cultivent des terres urbaines, s’opposent à l’artificialisation d’espaces vivants. Ça a été créé avec des gens du triangle de Gonesse et des personnes de l’association L’Autre champ, association des jardins partagés de Villetaneuse. Comment fait-on pour faire exister cette question de l’écologie autrement que par une injonction morale, des bobos-pédagos qui viennent t’expliquer comment vivre chez toi ? Et ce que je trouve très paradoxal… ça paraît très difficile a priori, j’ai mille exemples de rejet de l’étiquette écolo dans les quartiers populaires. J’en donne juste un. C’était en 2014, pendant la préparation du premierToxic Tour, dans le quartier de Lamaze à Saint-Denis, où débouche la bretelle de l’autoroute A1. Depuis des années, au moins dix ans, un collectif d’habitants réclame l’enfouissement de la bretelle, disant « cette bretelle d’autoroute est anxiogène, accidentogène, elle fait beaucoup de bruit, il faut l’enfouir ». Pour nous, c’était typiquement là qu’il fallait entamer les Toxic Tours, tu ne verrais jamais ça dans un quartier riche ! Je me rends donc à une réunion du collectif, plutôt des vieux — des vieux militants communistes, j’ai compris ensuite —, je me présente comme « plutôt une écolo ». Et là, ils me regardent ! Main sur le cœur : « Ah non, mais alors nous, on a rien à voir avec l’écologie ! ». J’insiste un peu, sur la pollution, sur la santé des riverains, etc. La rencontre se fait, et on finit par organiser ensemble le Toxic Tour ! L’obstacle n’était donc pas insurmontable… mais tout ça pour dire que l’écologie pose problème dans les quartiers populaires, alors même qu’il y a plein de pratiques écologistes dans ces quartiers. Tout dépend de la définition ! C’est là-dessus qu’on a essayé de travaillé l’été dernier avec Reprise de terres. On a eu le même malentendu sur la question du logement, avec plusieurs personnes qui sont impliquées dans des collectifs de locataires de logements sociaux. Pour nous, le lien avec la question de l’écologie, c’est que, en Île-de-France, les mobilisations écolos sont beaucoup sur la défense de terres : Aubervilliers, Triangle de Gonesse, Plateau de Saclay, Parc de la Courneuve, École d’agronomie de Grignon… un des lieux de la lutte environnementale aujourd’hui, c’est la destruction de toutes ces terres agricoles ou naturelles par le capitalisme immobilier. Et comme un des arguments des aménageurs pour détruire ces terres, c’est le besoin de logements, avec Reprise de terres, on a organisé une demie journée de discussion entre des gens qui viennent des luttes environnementales et des personnes qui sont dans des collectifs de lutte contre le mal-logement, qui défendent l’accès au logement. Et ça a un peu clashé ! Le groupe des personnes qui défendaient les terres, les « écolos », a été clashé par le groupe de défense des locataires, dont certains des membres étaient hyper choqués d’entendre parler de la défense des terres en tant que telle sans mettre au même niveau d’exigence le droit et l’accès au logement. C’était pas juste un désaccord poli, c’était un peu viscéral, ça avait trait à des différences existentielles — ou à un retour de la question de classe. L’embrouille portait notamment sur une friche, à Lille, la friche Saint-Sauveur, où des écolos défendent la biodiversité de la zone, contre les aménageurs, mais aussi contre des collectifs de défense d’habitants qui vivent dans des logements insalubres, et qui souscrivent d’une certaine manière au discours des aménageurs sur le besoin de logements. On a là une des tensions, pertinentes, qui nous bloquaient, et qu’on avait du mal à dépasser. Un autre conflit a jailli d’ailleurs, lié à ce frottement. Ça avait trait aux « préjugés raciaux ». On travaillait sur les terres urbaines, et dans un souci de ne pas avoir cette discussion entre blancs de classe moyenne seulement, on avait invité à participer aux rencontres la Cantine des femmes battantes, collectif de femmes migrantes de Saint-Denis. Parce que si tu considères que la subsistance est au cœur de la question écologique dans les quartiers populaires, alors la bouffe, c’est central ! Et la Cantine des femmes battantes c’est à la fois un exemple d’auto-organisation très intéressant, et de bonnes interlocutrices s’agissant de la question de la prise de terre dans les quartiers populaires. Elles sont donc venues à Notre-Dame-des-Landes, et sur place, la rencontre ne s’est pas vraiment faite : elles venaient aux réunions, mais les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elles se sentent à l’aise pour prendre la parole. Une frustration a monté parmi certaines de ces femmes, qui a commencé à transparaître quand il a été question du logement et qui a éclaté dans la plénière finale. Une des femmes battantes a reproché à l’assemblée son manque d’écoute durant les rencontres ; et d’autres amis, migrants, qui habitent à Saint-Denis et qui auraient potentiellement envie de travailler sur des fermes, étaient choqués du fait qu’on avait passé plusieurs jours à parler de terres agricoles sans parler de l’exploitation des sans-papiers, et de la manière d’éviter la reproduction de cette exploitation. Ça nous renvoyait à notre point de vue de blancs : on avait entre nous causé des terres, des terres en soi, sans considérer la réalité matérielle du travail de ces terres… Ça me fait penser à une intervention de Jean-Claude Balbot7, de l’Atelier paysan et du réseau Civam (Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), durant ces mêmes discussions, sur une expérience d’AMAP dans un quartier très populaire de Brest. Il arrive dans ce quartier, donc, en ayant le même discours qu’on est plein à avoir ici à Aubervilliers : dans les quartiers populaires, les gens bouffent des trucs dégueulasses, il faut donc créer des AMAP pour leur donner de la nourriture de qualité, etc. Bide total ! Les gens ne sont pas du tout intéressés par le panier, pourtant très peu cher. Et puis, Balbot donc, réalise qu’il est complètement fou ! Que ce n’est pas à lui, ou à d’autres écolos, de décider ce que les gens vont manger ; qu’il faut commencer par demander aux familles ce qu’elles aiment manger ou voudraient manger, et partir de là pour distribuer la nourriture. Ça les a conduits à faire ce qui serait une hérésie pour la majorité des AMAP : des paniers avec du Coca ! C’est une situation intéressante, qui met aux prises une perception écolo morale — ah ! Le Coca, l’impérialisme américain, la malbouffe, le sucre… — avec la réalité ; c’est un compromis avec tes voisins quoi, et peut-être le début d’une rencontre ! Entre les gens d’abord, puis entre l’écologie et les quartiers populaires. Bon, à propos de ce clash, de la friche lilloise, c’est la même chose, il faut inverser la logique. Au lieu d’un discours tout prêt, porter un regard attentif sur les pratiques. Et alors, tu te rends compte que ce sont des quartiers où il y a énormément de pratiques d’entraide. Et si tu penses l’écologie en ces termes-là, alors quelque chose est déjà là ! Il s’agit de reconnaître la part d’écologie dans les pratiques populaires, et de partir de là — par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a un mouvement très important, c’est celui contre la malbouffe dans les cantines scolaires… mouvement écolo qui ne dit pas son nom, et qu’il s’agit de rejoindre !
Il faudrait systématiser, de façon presque programmatique, les enquêtes encore une fois ! Prenons par exemple les marchés en Seine-Saint-Denis. C’est une pratique très répandue, il y en a plein, les gens ne vont pas qu’au Lidl ou au Carrefour, ils vont aussi beaucoup aux marchés. Mais c’est de la merde ce que vendent les marchés ! La même merde qu’à Lidl. C’est Rungis quoi. Quand c’est un peu chic, tu as deux étalages bios, mais à Aubervilliers, pas du tout. Il y a une économie, dégueulasse, mais aussi une « économie morale ». Combien de personnes qui font les marchés, qui vendent des produits dégueulasses, font en même temps travailler un cousin ou un ami en galère, un pote sans papiers… C’est un monde de solidarités, aussi, les marchés. Et on ne peut pas y répondre en disant que ce n’est pas bien d’acheter tel produit pakistanais ou tel produit à Rungis. Il faudrait toujours qu’on ait ça en tête quand on tente des trucs : que les gens ils vivent aussi, existentiellement, parce qu’ils ont la possibilité d’aller au marché couvert d’Aubervilliers quoi ! pour acheter des navets couverts de pesticides !
JL : Mais c’est pas parce que c’est couvert de pesticides qu’ils ont envie de l’acheter. C’est parce que les gens se connaissent, qu’il y a des arrangements permanents sur les quantités, sur le prix, etc. Ce sont des gestes communautaires, il y a quelque chose comme un lien social dans ces moments-là, une sorte de reconnaissance… En bien souvent, les marchés bios sont bien moins sympathiques ; l’étiquette bio devient donc repoussoir pour certaines personnes.
Pourrais-tu revenir, pour conclure, sur le lien entre ces histoires d’écologie populaire et la tentative des Reprise de terres ?
JL : Alors, pour aller vite, Reprise de terres est un groupe qui naît du confinement. C’est une plateforme collective d’enquête sur les conditions donc de « reprises de terres ». C’est inspiré d’une brochure parue sur la ZAD il y a deux ans, intitulée Prise de terre, qui reprenait le constat de Terre de Liens8 selon lequel dans les dix ans à venir, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite et que des millions d’hectares de terres agricoles vont se retrouver potentiellement disponibles. Par ailleurs, cette brochure fait le constat que, si la lutte de Notre-Dame-des-Landes a été très importante et inspirante, il lui a fallu dix ans pour sauver 1500 hectares. On ne va pas arriver, à ce rythme là, à empêcher le bétonnage ou l’artificialisation des terres. Il nous faut donc d’autres méthodes et d’autres stratégies. D’où la proposition de la brochure : ces terres, bientôt vacantes, il faut les prendre ! Cette proposition, elle parle à des groupes et des personnes très diverses, et c’est ce qui mène, au printemps 2021, aux Soulèvements de la Terre, mouvement de blocages, occupations, et désobéissance civile pour empêcher la destruction de terres agricoles. Et le pendant « réflexif », le pendant moins « activiste » de ce mouvement, c’est Reprise de terres. Une sorte d’enquête multiforme et collective — composée d’urbains et de ruraux, de chercheurs et de paysans, etc. — organisée en trois chantiers thématiques qu’on a déjà évoqués ici ou là dans notre discussion : les terres agricoles, la cohabitation avec le sauvage, et les terres urbaines. Il s’agit donc de faire exister la question de la ville, où la question des terres — friches, jardins ouvriers ou partagés, espaces boisés — ne se limite pas à sa dimension agricole. Pour l’instant, quelques textes ont été produits, pas beaucoup, dans un dossier publié dans la revue Terrestres en juillet et des rencontres ont eu lieu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au mois d’août, qui déboucheront sur une publication l’année prochaine.
Propos recueillis en octobre 2021.
A paraître dans le prochain numéro de la revue Parades.
- Plan local d’urbanisme intercommunal. [↩]
- « Nous étouffons », Collectif de défense des jardins des Vertus, 30 septembre 2020, Libération. [↩]
- Le 17 avril 2021 eut lieu la troisième mobilisation nationale « contre la réintoxication du monde » » (après les 17 juin et 17 novembre 2020). À Aubervilliers ce jour-là, plus de mille personnes manifestèrent contre le projet de Grand Paris Aménagement. [↩]
- Quartier populaire à proximité directe des jardins, aux confins d’Aubervilliers et de Pantin. [↩]
- Rencontre organisée par l’association Le Sens de l’humus et Les Communaux le 20 septembre 2021 aux Murs à pêches de Montreuil. Restitution vidéo disponible sur le site. [↩]
- Flaminia Paddeu est géographe, maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Paris Nord et chercheuse au laboratoire Pléïade. Ses recherches, à l’intersection des questions sociales et écologiques, portent sur les mouvements sociaux pour la justice environnementale et alimentaire dans les grandes métropoles aux États-Unis et en France (Détroit, New York, Grand Paris), et en particulier sur les pratiques alternatives et contestataires d’agriculture urbaine. Elle a publié entre autres dans les revues Espaces Temps, Métropolitiquesou Vacarme et a participé à l’ouvrage collectif Le capital dans la cité (Amsterdam). Elle est membre fondatrice et directrice du comité scientifique de la revue Urbanités. Nous renvoyons également vers son livre, sorti en octobre 2021, Sous les pavés, la terre. Agricultures urbaines et résistances dans les métropoles (Le Seuil). [↩]
- Jean-Claude Balbot est un des fondateurs de l’Atelier paysan, coopérative qui travaille avec les agriculteurs à la fabrication de leurs propres machines, outils et bâtiments, selon les besoins de leur activité. Il vient de publier, avec l’Atelier, Reprendre la terre aux machines, Le Seuil, 2021. Un compte-rendu de lecture de ce livre a été publié par lundimatin le 18 octobre 2021. [↩]
- L’objectif de Terre de Liens est de permettre à des agriculteurs d’acquérir des terres ou des parcelles cultivables pour préserver ce foncier de la spéculation et de l’artificialisation. [↩]